Sept ouvrages comme sept petits cailloux blancs ramassés au fil de balades littéraires pour vous conduire de L’Amérique à L’Extrême-Orient, en faisant escale en Europe et s’attardant au Moyen-Orient. Une balade qui s’étend sur plusieurs siècles, entre archaïsmes et libertinages, entre belle ouvrage et scénarios. Mais lisez plutôt…

Cet ouvrage n’a que 180 pages au compteur, mais sa densité est singulière : rien n’est en trop, tout est y signifiant. Les deux co-auteurs ont alterné les chapitres, et ce va et vient, entre l’histoire d’un Breton inconnu qui dut quitter la Bretagne pour tenter de se refaire sur des terres « neuves » et l’histoire du « pape » de la Beat Generation, est d’une grande cohérence. En effet, le premier brouille ses traces volontairement et change d’identité avec une aisance médusante, alors que ses écrits finissent par trop peser au second et l’obligent à endosser une identité qui n’est plus tout à fait la sienne.
Le premier est l’ancêtre de Jack Kerouac, un insaisissable fils de notable qui multiplia les frasques, et il a fallu tout le talent et toute la persévérance de la généalogiste Patricia Dagier pour le pister de Huelgoat à Kamouraska. Hervé Quéméner, lui, s’attache à faire du second un portrait tout en nuances, où apparaissent les contradictions et évolutions de l’écrivain dont les écrits influenceront la jeunesse occidentale dès 1957. Entre les deux personnages, des quêtes multiples et inabouties, des espoirs déçus mais toujours ranimés, des fantasmes et des rêves, jusqu’à ce travail de fond qui renoue le fil des événements et retrouve le fil d’Ariane.
Si le livre contribue à démystifier Jack Kerouac, celui-ci reste un personnage emblématique d’une époque. Il nous reste aussi une poésie et une écriture nourries d’expériences incandescentes et cet homme aperçu derrière le mythe, parfois faible, souvent proche des étoiles, exalté, mais qui sut surtout entraîner dans son sillage des êtres en recherche.
Jack Kerouac. De L’Amérique à La Bretagne de Patricia Dagier et Hervé Quéméner, Le Mot et le Reste, 2018 / 17 €.
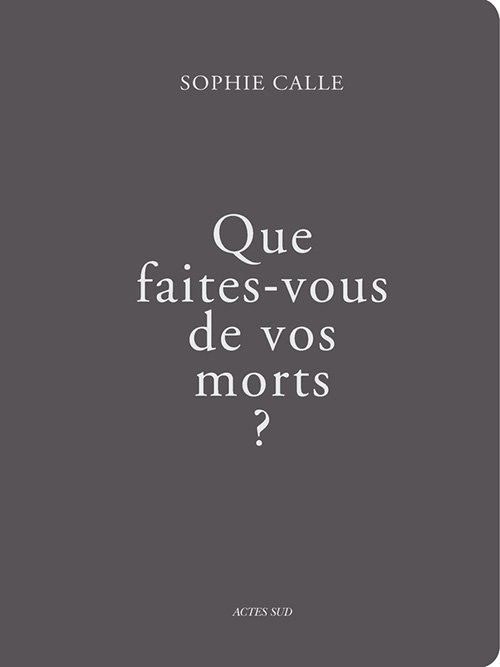
Est-ce étonnant de tenir entre ses mains un livre si peu commun quand l’ auteur en est Sophie Calle ? Cette plasticienne qui pose sur les événements de sa vie un regard d’artiste est déroutante et proche à la fois. Joli cocktail qui la rend irréductible et facilement identifiable à travers son œuvre.
Que faites-vous de vos morts ? fait suite à l’exposition que Sophie Calle avait installée au musée de la Chasse et de la Nature en 2017. Elle y mettait en scène des expériences intimes de la mort et avait proposé aux visiteurs de répondre à cette interrogation cruciale dans les livres d’or laissés à leur disposition. Yannick Haenel, dans Tiens ferme ta couronne, s’introduit nuitamment dans cette expo et si vous regrettez comme moi de ne pas l’avoir vue, vous pourrez vous consoler par son récit désopilant. Bref ! Sophie Calle a recueilli une multitude de réponses : décalées, provocantes, lapidaires ou loquaces, réfléchies, concernées et intimes, diverses comme le sont les caractères humains et les vécus.
Ce livre a revêtu une tenue de deuil : un camaïeu de gris, sobre et élégant avec sa tranche et ses lettres d’argent. Les photos sont les premières de Sophie Calle : prises dans un cimetière de Californie, elles déconcertent par leur anonymat : seul gravé dans le marbre, le lien qui unissait deux êtres, l’un parti, l’autre en sursis. Mother, Brother, 1st wife ou Father… Le reste n’est que vanité. Ces images dans leur nudité me semblent tellement plus saisissantes que celles de sépultures encombrées de colifichets.
Les textes sont donc d’abord ceux d’anonymes et la juxtaposition des écritures raconte un peu de chacun. Sophie Calle les a organisés et, en écho, insère ses propres textes déjà parus dans Des histoires vraies. Cette exploration polyphonique de « l’Absence », nécessairement, interroge le lecteur : ce livre n’a pas pour but de le réconforter mais il y trouvera la certitude qu’il appartient à l’espèce humaine, celle qui a conscience de sa finitude et qui pense la transmission entre individus.
Que faites-vous de vos morts ? de Sophie Calle, Actes Sud, 2019 / 32,50 €.
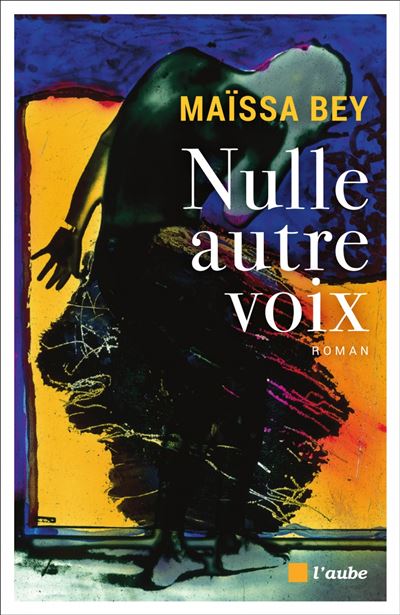
Maïssa Bey, écrivain algérienne féministe, de langue française, a tenu à rester vivre en Algérie, et ce même pendant la décennie noire lorsque ses écrits la rendaient particulièrement vulnérable. Cela lui confère un poids et une stature considérables des deux côtés de la Méditerranée. Ce nouveau roman nous donne à entendre la voix d’une femme qui sort de 20 années de détention. Nulle autre voix est écrit à la première personne du singulier et la narratrice apprivoise les mots pour elle et pour sa visiteuse, une universitaire qui nourrit son travail des récits de l’ex-détenue qui reste recluse dans son appartement. « Les murs de la prison me séparent toujours du monde. Ils sont dans ma tête. »
Maïssa Bey montre qu’il y avait, paradoxalement, plus d’humanité entre détenues qu’au dehors, lorsque votre crime – même expié – et votre condition de femme à jamais coupable vous condamnent à rester en marge de la société et de la vie. Ce roman livre deux portraits de femmes qui n’ont rien de commun, seulement un récit en partage. Au départ, un malaise s’installe face à cette sorte de vampirisation qui se fait, croit-on, au détriment de la narratrice et puis les cartes sont rebattues et ce qui paraissait évident au départ ne l’est plus. Qui des deux femmes utilise l’autre ? Condition féminine dans une société patriarcale, fonctions de l’écriture (objectivation, reconstruction du soi ou mise à distance de la souffrance) sont les sujets centraux de ce livre.
Certains passages sont éminemment poignants qu’il s’agisse de l’atmosphère dans la maison, restituée avec une grande économie de mots, ou de la description du « huis clos d’une pensée solitaire ». Pourtant, le lecteur ressent comme une faim inassouvie à la fin du roman, certains thèmes n’attendant que d’être développés.
Nulle autre voix de Maïssa Bey, L’Aube, 2018 / 19,90 €.
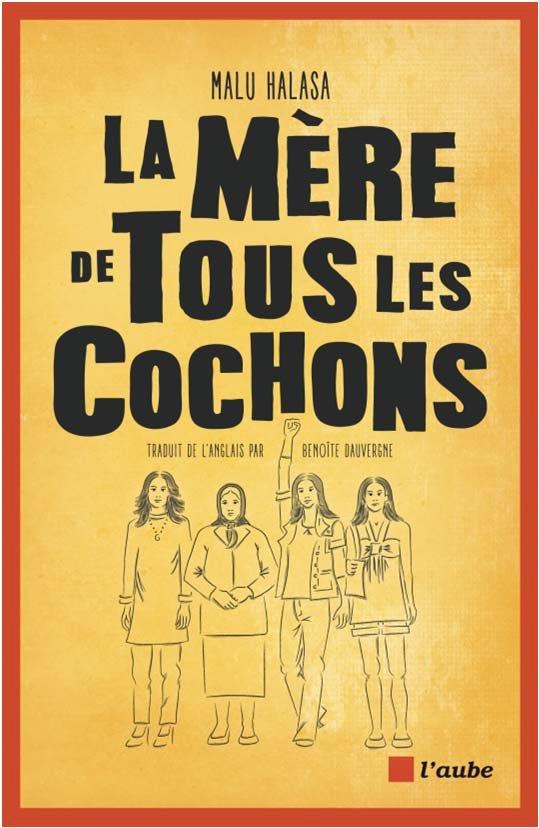
Coup de maître que ce premier roman de Malu Halasa ! Tous les ingrédients sont réunis à mon goût pour rendre la lecture de ce roman savoureuse : une foule de personnages attachants car leurs caractéristiques propres sont savamment décrites, des relations complexes comme la vie qui répond à tant de déterminismes et intérêts contradictoires, une histoire un peu loufoque (en tout cas loin de l’idée que se fait l’Occident d’une société Moyen-Orientale) et enfin une écriture qui restitue précisément l’ambiance, les tensions et les valeurs en jeu dans ce petit pays soumis à de multiples tensions.
Les protagonistes de l’intrigue sont tout autant les membres d’une famille étendue, les Sabas, que la Mère de tous les cochons, j’ai nommé Oum al-Khanaazeer. Celle-ci est l’objet de tous les rêves, de toutes les tractations mais aussi de dégoûts et de détestation inhérents à sa nature porcine. Sans jamais être didactique, ni recourir à la démonstration, ce livre, par un phénomène d’immersion indolore, nous donne les codes pour comprendre le fonctionnement de la société jordanienne. C’est truculent ! Et, pistache sur la baklava, on en sort plus instruit et plus averti de ce qui se trame dans ce contexte régional en ce début de XXI ème siècle.
La Mère de tous les Cochons, de Malu Halasa, (traduit de l’Anglais (Grande-Bretagne) par Benoîte Dauvergne), L’Aube, 2018 / 23 €.
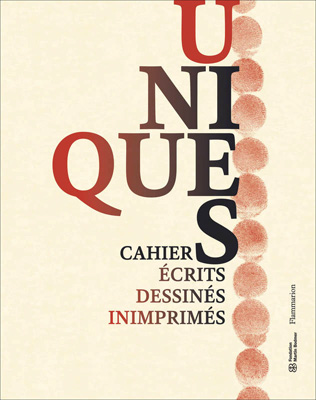
Unique(s). Cahiers écrits, dessinés, inimprimés : un trésor ! Présenté par un collectif dirigé par Thierry Davila, ce livre d’art accompagne une exposition en cours à la Fondation Martin Bodmer de Genève. Sont rassemblés les fac-similés de carnets qui n’avaient pas vocation à être imprimés. Des pièces uniques destinées à un usage privé.
L’introduction de cette somme érudite nous explique le principe à l’origine du choix des carnets. Elle préconise aussi une approche pour saisir la richesse prodigieuse des travaux exposés. Une sorte d’éducation du regard. En effet, ces carnets ou cahiers sont des œuvres entières et abouties, non des esquisses ou des brouillons. Ils sont réunis en constellations selon leur thème (philosophie, phénomènes de la nature, alphabets…) ou leur forme (A bords perdus, la vie dans les espacements…). Ainsi, il est recommandé de s’en tenir d’abord à une approche plasticienne, de privilégier la forme de l’objet, ce que Mallarmé appelait une lecture de surface. Ensuite seulement intervient « l’observation de la matérialité de chaque pièce ».
La composition de ces « écrits » singuliers, leur degré d’élaboration, le talent et l’implication de leurs auteurs (Stefan Zweig, Anatole France, Walter Benjamin et de nombreux d’autres, parfois anonymes) bouleversent le spectateur-lecteur. On assiste parfois à la construction d’une pensée, ou c’est un journal intime qui s’ouvre pour nous ou c’est un carnet de voyage qui garde les traces d’un cheminement ou c’est une archive du quotidien. Dessins, peintures, écritures, typographies, collages, photographies, extraits d’articles de journaux ou blancs sur les pages, tout concourt à faire de ces objets des œuvres d’art intenses. Les cahiers de Robert Droguet m’ont particulièrement touchée par la rigueur et l’inventivité qui se dégagent de leur composition. Pour apprécier pleinement les objets dévoilés, il faut s’attarder sur le texte de présentation qui introduit auteur et contexte. Cet ouvrage a nécessité un énorme travail préalable et la contribution de nombreux chercheurs, mais le résultat est là : fantastique !
Unique(s). Cahier écrits, dessinés, Inimprimés. Ouvrage collectif sous la direction de Thierry Davila, Flammarion, 2018 / 65 €.

Avec Le Cinéma de Guillaume Apollinaire, de Carole Aurouet, nous découvrons à quel point le poète était un visionnaire, un précurseur, un artiste total. En effet, à ses débuts, les milieux intellectuels et cultivés accusaient le cinéma d’immoralité et d’influence néfaste sur le public. Mais Guillaume Apollinaire, lui, très tôt, s’intéresse à cet art nouveau : il assiste aux projections, se fait critique de cinéma, défend cette invention moderne et l’analyse, la promeut, l’introduit dans ses écrits littéraires et rédige même des scénarios : « Toute invention trouve en moi un admirateur éclairé, du moins enthousiaste. »
Ses positions montrent quel homme libre il était, poussé en avant par sa conception du progrès, n’ayant de cesse de combattre la mauvaise réputation de la « lanterne magique ». De même qu’il participe à l’aventure du surréalisme dès son origine, il entrevoit dès le départ les immenses potentialités de ce médium nouveau, lui prédit un développement exponentiel et une place essentielle dans la vie des gens et des arts.
Pour Apollinaire, le cinéma est un nouveau langage poétique : « On peut être poète dans tous les domaines, il suffit que l’on soit aventureux et que l’on aille à la découverte ». Magnifique citation qui confirme sa place, ô combien justifiée, au panthéon des poètes !
Dans cet ouvrage, sont reproduits les fac-similés de ses scénarios manuscrits : La Bréhatine écrit avec André Billy et un autre, inachevé, C’est un oiseau qui vient de France. Cette iconographie est fort émouvante. L’écriture nerveuse, les ratures, les soulignages, la composition des pages, les petits dessins, les notes en marge : tout participe à renforcer la présence du poète, à nous rapprocher de lui.
Guillaume Apollinaire s’est éteint il y a 100 ans, c’était hier. Ce bel ouvrage – beau par sa forme et par son fond – éclaire d’un jour nouveau la personnalité du poète et sa contribution à l’émergence de nouvelles formes d’art. Que c’est bon d’être ainsi surpris !
Le Cinéma de Guillaume Apollinaire. Des Manuscrits Inédits pour un nouvel éclairage, de Carole Aurouet, Éditions de Grenelle, 2018 / 28 €.

C’est un roman chamarré, exubérant, au sens où l’on parle d’une forêt exubérante, que ce roman de Jean-Marie Blas de Roblès. Le Rituel des dunes nous transporte dans le monde des expatriés, un monde où l’on se permet toutes les excentricités, où la folie n’est jamais loin, où les expériences les plus fantasques s’échangent. On est tout de suite happé par l’écriture follement évocatrice de l’écrivain, l’atmosphère décrite est immédiatement palpable grâce à ses descriptions qui alertent l’ouïe, la vue, l’odorat. Pas un mot de trop, le sens de la formule et une foule de détails : tout y est d’une délicate justesse.
« Les histoires engendrent les histoires à l’infini » : cette citation empruntée au narrateur reflète parfaitement le déroulement du récit et semble correspondre à la manière d’écrire de l’auteur. Beverly est-elle une géniale mythomane ou un personnage extravagant ayant vécu mille vies ? Sa folie est-elle réelle ou maîtrisée ? Le lecteur croit à toutes ces histoires qui s’enchaînent sur la toile de fond d’un pays un peu inquiétant, sans jamais se poser la question de leur plausibilité. La fin du roman elle-même convainc, car depuis les premières pages on sent les personnages écartelés entre des perceptions contraires, des expériences « hallucinantes ».
Le Rituel des dunes, de Jean-Marie Blas de Roblès, Zulma, 2019/ 20 €.
Swaz